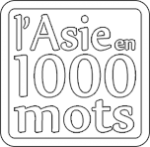- Femmes Kankanaey qui préparent des légumes, Mountain Province, Région Administrative de la Cordillère
Crédits : Jacob Maentz (www.jacobimages.com/2013/05/igorots-cordilleras)
L’Igorot : cartographie d’une différence hiérarchique aux Philippines
Les revendications actuelles des Igorot s’inscrivent dans une série d’oppositions hiérarchiques engendrées par les expériences différentiées de la population des Philippines à la colonisation espagnole (1565-1898). Les habitants des basses-terres, qui durent se plier à la « Croix et la Couronne », se distinguèrent des montagnards de la Cordillère, région nordique de l’île de Luçon, puisqu’ils parvinrent, par adresse et fortune, à résister aux missions civilisatrices et commerciales des envahisseurs. L’ « indigène » devint alors la figure emblématique de la résistance, l’archétype du Philippin « primitif », brave et vaillant – mais aussi le symbole d’une sauvagerie indisciplinée et indésirable.
L’occupation américaine (1898-1946) formalisa cette discrimination ethnoculturelle et géographique par des outils scientifiques et technocratiques, comme en témoigne la création d’un répertoire de classification par un zoologue américain, Dean C. Worcester, au début du 20e siècle et la mise sur pied de bureaux d’administration visant à « civiliser » les tribus « non chrétiennes » et « sauvages » par l’éducation et la religion. Cette classification exacerba les inégalités qui s’articulèrent, cette fois, autour d’une corrélation supposée entre les différents attributs physiques des Philippins et leurs aptitudes mentales.
De l’uniformité nationale à une distinction ethnojuridique
La création de la République des Philippines en 1946 stimula des campagnes d’assimilation visant l’unification et le développement national. Pour ce faire, la Commission on National Integration (CNI) et l’Office of the Presidential Assistance on National Minorities (PANAMIN) s’impliquèrent dans la pacification des populations réfractaires au progrès, défini d’après les canons d’une modernité industrielle et capitaliste.
Le projet hydroélectrique de la rivière Chico, institué lors de la dictature de Ferdinand Marcos (1972-1981), marqua un point tournant dans les luttes menées par les montagnards de la Cordillère pour la reconnaissance et l’obtention du droit à l’autodétermination, ainsi que pour l’accès aux ressources naturelles comprises dans leurs domaines ancestraux. Comprenant l’érection de quatre barrages hydroélectriques visant à contrecarrer la crise énergétique dans les basses-terres, ce projet prévoyait submerger, par le fait même, plus de 342 000 hectares de terres fertiles, exigeant la relocalisation forcée de plus de 100 000 personnes. Des décrets présidentiels renversèrent, à cette fin, des lois menaçant son exécution, dont le Ancestral Lands Decree, qui déclarait les terres occupées par les « National Cultural Minorities » de « alienable and disposable », et le Forestry Reform Code of the Philippines, qui soutenait le droit du gouvernement à optimiser les bénéfices liés à l’exploitation des domaines publics et à maximiser la productivité du territoire national.

- Homme de Kalinga
Crédits : Jacob Maentz (www.jacobimages.com/2013/05/igorots-cordilleras)
L’opposition vigoureuse déclenchée par ce projet engendra des alliances qui mobilisèrent des institutions et des pratiques coutumières, ainsi que des campagnes de dénonciations menées par des activistes locaux en partenariat avec l’Église catholique. Certains se tournèrent même vers les luttes armées du New People’s Army (NPA), la faction militante du Parti communiste des Philippines, en réponse aux actes criminels que perpétrèrent les milices de l’État. L’assassinat d’une figure de proue de cette résistance, Macliing Dulag, en 1980 entraîna la suspension indéfinie du projet et l’amplification du mouvement autonomiste au sein de la Cordillère. Celui-ci catalysa l’implantation de mécanismes juridiques soutenant les droits d’une population qu’on définit alors d’indigenous cultural communities, historiquement marginalisée et garante d’une identité territorialisée et de savoirs et d’institutions gouvernementales traditionnels.
Les Philippines devinrent ainsi l’un des premiers pays au monde à formellement reconnaître les droits autochtones, d’abord en 1988, par le Cordillera Regional Consultative Commission Act (Republic Act No. 6658) instituant une commission chargée d’établir un Organic Act pour l’autonomie régionale de la Cordillère [3], puis par l’entremise des Certificates of Ancestral Domain Claim en 1993 et, finalement, de manière plus explicite, par l’établissement du Indigenous People’s Right Act en 1997 [4]. L’ « indigène » devint alors une catégorie juridique importante, offrant à ses représentants des privilèges ainsi qu’un pouvoir notable, tel qu’une autorité sanctionnée par l’État leur permettant d’accepter ou de refuser la mise en œuvre de projets de développement provenant d’organisations publiques et privées.
Les possibilités et les restrictions de l’identité « indigène »
Alors que l’ « indigénéité » définirait, en principe, une majorité de citoyens descendant d’une lignée généalogique exclusive aux Philippines, ce statut s’applique exclusivement, d’après la loi, à des sociétés « homogènes », « authentiques » et intrinsèquement distinctes d’une culture dominante. Ne référant, dès lors, qu’aux représentants d’une différence forgée à l’ère coloniale, le statut d’ « indigène » octroie à ses détenteurs des capacités juridiques qui dépassent celles de leurs concitoyens, niant ainsi leurs similitudes. Cette catégorie identitaire exige, de surcroît, l’incorporation, la mise en scène et la validation de ces imaginaires coloniaux ainsi que des inégalités et des préjugés (positifs et négatifs) sur lesquels ils reposent. Elle incarne et reproduit, conséquemment, les différences ayant permis d’assujettir, discipliner et « développer » les populations qui se désignent ainsi, exigeant qu’elles défendent et valorisent cette discrimination, tout en refusant, par ailleurs, d’adopter des modes de vie « modernes ».
Légende (photo de couverture) : Province de Kalinga, région administrative de la Cordillère.
Crédits : Karen Bouchard (2016)