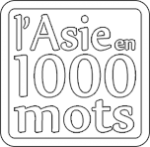Introduction
Lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping, la Nouvelle Route de la Soie (NRS) a pour but de renforcer les échanges commerciaux, culturels et diplomatiques entre la Chine globalement. En raison de leur proximité géographique, les nations d’Asie du Sud-Est figurent parmi les principaux bénéficiaires de cette initiative, devenant ainsi des partenaires économiques clés. Toutefois, la concentration du pouvoir, l’absence de transparence dans les décisions politiques et la répression des voix dissidentes restreignent considérablement la possibilité de contestation citoyenne. Cette étude se propose d’analyser les enjeux liés au phénomène du land grabbing dans le cadre de la NRS, avec un accent particulier sur le Cambodge.
Contexte politique du Cambodge
L’ascension de Hun Sen au pouvoir après l’autogénocide des Khmers rouges en 1979 demeure ambiguë. Trente-six ans plus tard, après la reconnaissance officielle de Sam Rainsy comme chef de l’opposition, les tensions politiques au Cambodge ont dégénéré en violences. L’opposition a été expulsée de l’Assemblée nationale, et son leader a choisi de s’exiler en France. Parallèlement, le gouvernement de Hun Sen a adopté de nouvelles lois renforçant les pouvoirs de son parti, le Parti du peuple cambodgien (PPC), lui donnant la possibilité de dissoudre d’autres partis politiques. Le système électoral cambodgien repose désormais sur un scrutin proportionnel à liste fermée, où les électeurs votent pour un parti plutôt que pour des candidats individuels, laissant aux partis le soin de désigner les élus.
En tant que modèle autoritaire, la Chine présente une alternative à l’ordre libéral occidental. Cette approche a trouvé un accueil favorable auprès du PPC, qui, tout en bénéficiant des investissements chinois, a adopté des pratiques répressives similaires, restreignant les libertés politiques afin de maintenir sa stabilité. Dans ce contexte, Hun Sen a transféré le pouvoir à son fils, consolidant ainsi une transition dynastique. L’opacité des processus décisionnels et l’absence de consultations publiques sur les projets liés à la NRS entravent toute discussion ouverte sur leurs impacts sociaux.

Hun Sen et son fils. Source : https://www.aljazeera.com/news/2021/12/2/cambodian-leader-hun-sen-says-he-backs-eldest-son-to-succeed-him
Définition
Le land grabbing[1], ou accaparement des terres, survient lorsque des terres sont saisies sans justification valable et en l’absence d’un cadre juridique approprié. Ces pratiques s’appuient souvent sur des lois locales perçues comme injustes et illégitimes, permettant ainsi la violation des droits des populations. Face à cette situation, les gouvernements préfèrent détourner la responsabilité en imputant la faute aux entreprises étrangères impliquées[2]. Ce mécanisme de dissimulation vise à masquer les défaillances des autorités locales, qui, sous prétexte de promouvoir le développement économique, ont facilité l’émergence de pratiques nuisibles aux communautés locales.
Le cas du Cambodge
Ces accaparements, associés à des projets d’infrastructure de la NRS, ont entraîné des violences et des intimidations envers les populations locales. Depuis 2019, plus de 22 021 familles[3] ont été touchées par des saisies massives de terres, et des dizaines de milliers d’autres vivent dans l’incertitude en raison de conflits fonciers non résolus. La NRS a exac erbé ce phénomène. Le land grabbing représente un élément clé de l’histoire du royaume khmer. Après la guerre contre les Khmers rouges, les droits fonciers demeurent flous, créant ainsi une relation ambiguë entre le gouvernement et les survivants du conflit. Les familles étaient autorisées à cultiver de petites parcelles, sans pour autant rétablir la propriété privée ni les droits fonciers antérieurs[4]. Mais avec l’arrivée de nouveaux investissements, le phénomène s’est intensifié, au point de ne plus passer inaperçu. À titre de précision, ce ne sont pas les autorités chinoises qui renforcent directement l’accaparement des terres en Asie du Sud-Est, mais plutôt les gouvernements locaux, désireux de promouvoir les projets chinois liés à la Nouvelle Route de la Soie (NRS). Ceux-ci tirent parti de la situation en attribuant la responsabilité à la Chine pour légitimer leurs propres actions. La Chine demeure néanmoins un acteur d’influence majeur.
En 2020, des gardes de sécurité cambodgiens avaient dispersé une manifestation près de l’ambassade de Chine en réaction à des projets supposés visant à renforcer la présence militaire de Pékin dans le pays[5]. Le gouvernement cambodgien a fermement démenti les informations selon lesquelles un accord secret aurait permis à la Chine de déployer ses forces à la base navale de Ream, située dans le Golfe de la Thaïlande[6]. De nombreuses familles, installées dans ces régions depuis des générations, se retrouvent privées de leurs terres sans compensation adéquate, renforçant ainsi un sentiment d’injustice et rendant l’accès aux recours juridiques difficile. Trois ans plus tard, dix militants ont été condamnés à un an de prison pour leur implication dans des conflits fonciers, et, à leur sortie, ont été contraints de verser des indemnités à un magnat local, illustrant la domination des autorités et des acteurs économiques puissants sur les terres agricoles et les droits des communautés[7]. Cette situation met en évidence l’inégalité d’accès au système de justice, qui privilégient largement les intérêts des gouvernements, laissant les populations locales sans possibilité de recours.
Conclusion
En conclusion, la Chine représente un facteur sous-jacent de déstabilisation sociale, tout en étant perçue comme un partenaire économique incontournable. Cette méfiance s’explique en partie par l’absence de dialogue entre les différentes parties prenantes. Les attentes du Cambodge en matière d’infrastructures et de croissance économique se heurtent à une réalité complexe. Le pays est pris dans un cercle vicieux : il doit concilier son besoin pressant de développement avec la préservation de sa souveraineté, tout en répondant aux aspirations de sa population afin de maintenir la stabilité politique, condition essentielle à la poursuite des investissements chinois. Si la Chine n’est pas directement responsable des expulsions, elle exerce une influence décisive sur les autorités locales qui les mettent en œuvre.
[1] Baker-Smith, Katherine, et Boruss Miklos Attila, Szocs, 2016. « What Is Land Grabbing ? A Critical Review of Existing Definitions » in Eco Ruralis, 2.
[2] Ibid., 15.
[3] Shorten, Laura, 2024. Cambodia’s Land-Grabbing Crisis. The Contrapuntal. En ligne https://thecontrapuntal.com/cambodias-land-grabbing-crisis/
[4] Trzcinski, Leah M., et Upham, Frank K., 2014. Creating Law from the Ground Up : Land Law in Post-Conflict Cambodia. Cambridge University Press, 55 - 77.
[5] Reuters in Phnom Penh, 2020. « Cambodia breaks up anti-China protest in capital over alleged military base » in Morning China Post, éd. du 30 octobre.
[6] Human Rights Watch, 2020. Cambodia : Hun Sen Threatens Families of Activists.
[7] RFA, 2024. Some 200 Urge Action on Long-Running Cambodian Land Conflicts.