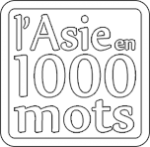On le nomme « mouvement tournesol ». Il paralyse depuis deux semaines le parlementarisme taïwanais et ravive chez les Taïwanais cet esprit de participation politique qui somnolait jusqu’à tout récemment. En effet, le 18 mars dernier, des dizaines de milliers de manifestants se sont joints à un important sit-in et bloquent depuis maintenant deux semaines les rues entourant les organes législatif et exécutif du gouvernement à Taipei, tandis que des centaines d’autres sont barricadés dans le parlement, qu’ils occupent depuis tout aussi longtemps. Les rues fourmillent de bénévoles : des équipes s’affairent au nettoyage et à la collecte de déchets, tandis que d’autres distribuent de la nourriture, des rafraîchissements, des couvertures ou des imperméables gratuitement. Des scènes sont installées un peu partout et les gens témoignent, débattent ou font des discours. On campe dans les rues. Une telle mobilisation est sans précédent. Le 30 mars, c’est le comble : plus d’un demi-million de manifestants [1] déferlent sur le boulevard Ketagalan, adjacent aux rues déjà occupées et faisant face au palais présidentiel, pour demander le retrait de l’accord sino-taïwanais sur le commerce des services, du moins dans sa forme actuelle, et la mise en place d’un organe destiné à surveiller de futurs pourparlers ou d’éventuelles négociations entre la Chine et Taïwan.
Bien qu’il soit d’origine étudiante, le mouvement tournesol est un regroupement hétérogène composé de partisans de tous âges provenant de toutes les strates de la société. Il s’oppose à la signature de l’accord sino-taïwanais sur le commerce des services et surtout à la façon controversée dont le Kuomintang (KMT) – parti pro-chinois au pouvoir – a géré les délibérations et le processus législatif.
Signé à Shanghai en juin 2013, cet accord vise à ouvrir les marchés des services chinois et taïwanais en réduisant ou éliminant les restrictions sur le commerce des services entre ces deux États [2]. En ce qui concerne Taïwan, le KMT espère que cet accord contribue au développement économique de l’île et offre aux entreprises taïwanaises une plus grande part du marché des services chinois. Ce qui a priori semble potentiellement profitable pour Taïwan trouble toutefois une grande partie de la population.
Tout d’abord, on reproche au président taïwanais Ma Ying-Jeou et à son parti, le Kuomintang, d’être antidémocratique en précipitant le processus législatif sans consulter les citoyens ni étudier l’accord. Le KMT, après avoir subi des pressions répétées de la part de la population, avait fini par promettre, en juin 2013, que l’accord serait examiné par un groupe d’experts – ceux-ci provenant notamment du milieu académique, de la société civile et du monde des affaires – et qu’on délibérerait des articles un à un. La réalité fut toutefois bien différente : le KMT a précipité la tenue d’audiences en une semaine avant d’annoncer que, de toute façon, l’accord ne pouvait pas être amendé et qu’il devrait être accepté tel quel [3].
En mars 2014, Chen Chi-Mai, un législateur du Parti démocrate progressiste (DPP), a tenté de rouvrir ce dossier pour faire l’examen des articles un à un, comme ce qui avait été convenu, mais sans succès. Les législateurs du KMT ont non seulement empêché l’examen d’avoir lieu, mais ont expédié l’accord directement en formation plénière pour qu’il soit rapidement voté. De ce fait, le Kuomintang, qui possède une majorité de 64 des 113 sièges au parlement, a contourné la révision de l’accord par le comité législatif. Ce processus législatif pour le moins controversé a donné le coup d’envoi aux manifestations qui n’ont cessé de gagner en importance depuis [4].

- "Contre la boîte noire" (allusion au processus à huis clos et au manque de transparence du gouvernement en place).
Bien que cet accord soit loin de faire consensus au sein de la population, il n’y a pas que des préoccupations de nature économique qui alimentent la mobilisation. De nombreux manifestants, faisant écho à la majorité de la population, se montrent inquiets face à ce qu’ils perçoivent comme une tentative du gouvernement Ma, dont le niveau de popularité est en chute libre [5], de se rapprocher à tout prix de la Chine. On accuse notamment Ma Ying-Jeou d’être soumis à l’influence de Beijing [6].
Pour de nombreuses personnes, l’accord sino-taïwanais sur le commerce des services est vu comme une façon détournée de vendre Taïwan à son voisin continental en ouvrant ses marchés et en accueillant l’investissement chinois, ce qui pourrait potentiellement contribuer au développement économique de Taïwan, au détriment de son autonomie et de sa culture.
Environ 90 % des Taïwanais rejettent l’idée d’unification avec une Chine communiste dirigée par un parti unique [7]. Il est généralement admis que tout rapprochement avec Beijing pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la démocratie taïwanaise et les libertés difficilement acquises dont jouissent les Taïwanais depuis les vingt dernières années.
Chaque nouvelle entente avec Beijing fait craindre que Taïwan ne devienne le prochain Hong Kong, où l’autocensure et l’influence du gouvernement chinois se font aujourd’hui sentir [8]. Ce processus de contrôle médiatique est déjà enclenché à Taïwan, où l’homme d’affaires Tsai Eng-Meng, favorable au gouvernement chinois, a fait l’acquisition en 2012 de 60 % de China Network Systems, plaçant 23 % des Taïwanais abonnés au câble à sa disposition [9]. En effet, les médias favorables au gouvernement communiste chinois ou au Kuomintang ont travaillé d’arrache-pied dans les dernières semaines pour inonder les ondes de propagande progouvernementale et on a pu observer la même chose en ligne sur des plateformes comme Wikipédia, où tout contenu faisant état de brutalité policière a été bloqué [10].
La manifestation monstre du 30 mars envoie un message clair au président Ma : les Taïwanais ne renonceront pas à leurs revendications et continueront leur lutte pour une démocratie plus participative. Le mouvement ne semble pour l’instant pas vouloir s’essouffler, et Ma Ying-Jeou pourrait être contraint de revoir sa position face à une pression croissante. L’issue de cette mobilisation aura non seulement une importance majeure pour l’avenir des relations commerciales entre Taïwan et la Chine, mais aussi pour celui de la démocratie taïwanaise, qui risque de se faire plus participative et d’être surveillée plus attentivement par les citoyens.
Crédits (photo de couverture) : Jimmy Kang.
Crédits (photo 1) : Julia Kao.
Crédits (photo 2) : Getty Images.